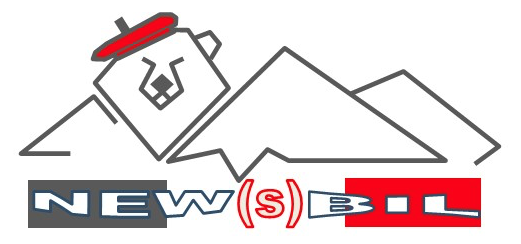

Ingénieur-e : un métier à forte valeur "politique" ajoutée !
« Politique », voilà un terme dans l’air du temps ! Mais ici, je ne vous propose pas de parler politique comme dans la récente actualité médiatique, mais plutôt dans son sens philosophique, celui que la Grèce Antique nous a donné : l’organisation de la cité. D’ailleurs, le métier d’ingénieur trouve son origine à cette époque jusqu’à l’Âge classique avec les architectes-bâtisseurs-constructeurs-inventeurs qui sont les proto-ingénieurs.
L’apparition du terme ingénieur est tardive ; au XVIIème siècle, l’ingénieur est l’inventeur de machines de guerre, ou encore le responsable de la conception et de l’exécution de fortifications ou de sièges de places fortes. Dans la première moitié du XIXème siècle, lors de la première révolution industrielle, ce métier acquière ses lettres de noblesses, notamment en France avec la scission entre l’ingénieur civil et l’ingénieur d’État. Et plus particulièrement au XXème siècle, époque à laquelle l’industrialisation aux États-Unis se développe vigoureusement, et la reconstruction d’après-guerre en Europe est nécessaire ; c’est notamment la reconnaissance de la victoire des Alliés par leur avancée scientifique et technologique et l’affirmation du rôle de l’ingénieur par rapport à la poursuite de cette avancée qui sous-tend l’importance de ce métier.
L’influence de l’ingénieur et de l’ingénierie sur le monde est aujourd’hui indéniable à bien des égards : c’est un métier à forte valeur « politique » ajoutée. L’ingénieur transforme la société, ses pratiques et sa culture et les systèmes techniques sont des structures qui contraignent des choix de vie et d’organisation, comme en témoigne la démocratisation du smartphone par exemple : un nouveau besoin – ou plutôt une nouvelle mode – est apparue, contraignant parfois les familles les plus modestes à le satisfaire chez leurs plus jeunes enfants, quitte à ce qu’un crédit sur la consommation leur pendent au nez ; de nouveaux comportements sont apparus, comme le selfie ou écrire un sms en marchant : qui n’a jamais failli se cogner à un poteau ou à une personne tellement il était aspiré par son téléphone ? Mais son influence ne se limite pas à la consommation, elle touche bien évidemment l’organisation de la production industrielle sous toutes ses facettes (objets, alimentation, énergie, eau, mais aussi le social, la culture et même l’économie) : l’ingénierie devient la norme de création et de réalisation des projets, même dans les domaines les plus humains et sociaux, une méthodologie qui s’universalise dans tous les secteurs de la société. Et finalement, quoi de plus logique, pour démontrer son impact politique que de rappeler sa connivence avec l’État, grâce à l’avènement de la technocratie ; notons tout d’abord l’invention des sciences politiques, où la méthode projet permet de créer les politiques publiques. Mais n’oublions pas aussi le déni de l’expertise citoyenne, comme on peut le constater dans l’actualité récente avec le barrage de Sivens ou encore l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes : l’intérêt économique qui prime sur les enjeux écologiques, avec des études technico-économiques biaisés dans les deux cas, tout comme les concertations publiques… Rajoutons aussi l’explosion des appels à projet, leur formalisation à partir du cadre logique managérial « objectifs-moyens-résultats attendus-indicateurs » et leur évaluation suivant le triptyque « coût-délai-qualité ». Bref, les sciences et techniques de l’ingénieur ne sont plus réfléchies par leurs praticiens ! Elles se jouent des conséquences qu’elle peut avoir sur la nature et sur les structures sociales, elle revêt un caractère autonome en s’affranchissant des lois environnementales et sociologiques, et n’existe qu’essentiellement pour l’intérêt économique rajoutant quelques paramètres socio-environnementaux à la marge seulement pour redorer son blason et faire taire les critiques…
Mais comment l’ingénierie a pu se construire de la sorte ? Il n’en a pas toujours été ainsi, et des questions sur le rôle, la fonction sociale et la responsabilité sociale de l’ingénieur ont connu de nombreux débats ; mais ces derniers se sont toujours conclus par une évolution de l’ingénierie en fonction des régimes politiques dominants la société et ce depuis l’avènement des écoles Polytechnique et des Arts et Métiers : les sciences et techniques de l’ingénieur ne sont pas neutres, elles comportent évidemment des biais idéologiques. Et depuis les années 1970-80, avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan et François Mitterrand, le courant dominant de la société est d’ordre néo-libérale et impose des politiques publiques, s’appuyant sur le double postulat suivant :
- « le postulat du primat absolu des problèmes économiques sur tous les autres
- le postulat de la profusion sans limite des ressources naturelles (ou de leurs substituts techniques) ».
Dans le domaine scientifique et technique, le néo-libéralisme s’appuie sur la théorie néo-classique. Cette dernière pose un regard sur le monde et l’impose, c’est-à-dire qu’elle structure réellement la vie économique et sociale à partir d’une pure projection mathématique (et se méfie des analyses quantitatives soi-disant trop ouvertes à l’interprétation subjective), avec notamment le modèle de la rationalité individuelle non coopérative de l’homo economicus et le principe de libre concurrence. Quand elle se pose en science de constat, les mêmes outils simplifient la complexité des réalités sociales et elle se rend incapable de les constater. Elle impose la croissance et le laissez-faire économiques comme seuls objectifs de l’humanité, en croyant qu’ils permettront de régler les problèmes sociaux et les conflits politiques. L’ingénierie adhère aux intérêts que portent la théorie néo-classique : elle vise la maximisation du profit, et conceptualise des objets techniques dont les usages sont la plupart du temps individualisés – ce qui permet d’ailleurs de démultiplier les profits face à des usages collectifs –, comme la voiture : n’est-il d’ailleurs pas choquant de voir à notre époque, où les préoccupations écologiques, s’intensifient des bouchons avec des voitures qui ne comptent à leur bord qu’une seule et unique personne. Quant à la libre concurrence, elle induit la nécessité d’optimisation et d’innovation des technologies, des processus et des organisations, conçues avec le même simplisme spéculatif qu’elle fait sur le réel dans ses outils d’analyse du besoin et de représentation du consommateur : combien d’ingénieurs ayant conçu un frigidaire pour conserver le froid se seraient doutés que celui-ci serait devenu un objet pour y apposer des photos, une liste de course, ou parfois pour les modèles de petites tailles, servir d’extension du plan de travail ; et combien se sont demandés si les usagers s’en servent mal, comme c’est le cas pour la conservation des fruits et légumes, dont la plupart mûrissent plus vite au contact de l’humidité ambiante dans l’appareil que s’ils n’avaient été conservés à l’extérieur, et
qui plus est, augmente la consommation électrique de l’objet.
Ce courant de pensée scientifique et idéologique repose et enrichit le développement du modèle socio-économique capitaliste de la société qui s’impose depuis le XVIIIème siècle, dont de nombreuses définitions se sont discutées tout au long de son histoire suivant les représentations que s’en sont faits et s’en font ses partisans et ses objecteurs ; mais elles gravitent toujours autour des notions d’accumulation du capital, de recherche de profit, de propriété privée, d’actionnariat et de salariat. Au fil des siècles de pratiques de l’ingénierie, cette dernière a su se doter d’outils d’organisation du travail, et surtout d’implication des travailleurs pour pouvoir pérenniser le capitalisme et soumettre les salariés aux objectifs économiques des actionnaires et des gestionnaires des entreprises. Rappelons qu’à partir de la 1ère révolution industrielle jusqu’aux années 1930, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui : 60h de travail par semaine, une journée de congé par semaine, pas de vacances, des salaires déplorables, des travailleurs meurent à l’usine, au champ et dans la mine, pas d’ascension sociale possible, l’emploi des enfants, … L’action syndicale est forte et la révolte gronde. C’est ainsi que l’Organisation Scientifique du Travail, dans les années 1910, vient « colmater la fissure » organisationnelle, appliquant une théorie mécaniste à une réalité sociale : Taylor s’inspire de sa thèse sur la coupe des matériaux pour la créer, et cherche à optimiser la division du travail ; Ford rajoute que l’implication et la collaboration des travailleurs ne peut se faire sans répondre aux intérêts de la classe ouvrière : c’est la démocratisation de la voiture, rendue possible par l’augmentation des salaires et la réduction des coûts de production grâce au travail à la chaîne, ainsi que l’allégement de la charge hebdomadaire de travail : on peut y voir une forme de ré-humanisation de l’organisation sociale du travail, on ne considère plus seulement l’ouvrier comme un rouage, mais aussi comme un être de besoins, mais des besoins qui se résument pour l’instant au physiologique (manger, boire, avoir une maison salubre, s’habiller, se déplacer ...). Il est important aussi de noter qu’en 1930, l’ingénieur finit par acquérir le statut qu’on lui connaît aujourd’hui : suite à la crise de 1929, l’art du commandement est enseigné en écoles afin de permettre aux ingénieurs de sortir de leur place de techniciens et d’occuper la place du patronat jugé trop défaillant. Mais revenons à nos années 80, où émergent l’idéologie néo-libérale, et le bien-nommé management que nous connaissons tous. Ce dernier fait bien évoluer la représentation de l’humain, même si celle-ci se limite toujours à le considérer comme un être de besoins, besoins qui ont bien changé : la pyramide de Maslow intègre 5 degrés de besoins avec à la base les besoins physiologiques et au sommet l’accomplissement personnel. Ainsi le management garantit, au-delà de l’implication, une adhésion des collaborateurs – qui signifie travailleurs en novlangue managériale –, à la culture de l’entreprise (comme peuvent en témoigner notamment les chartes éthiques). Le management interdisciplinarise l’organisation du travail, pour sortir d’une conception mécanique, elle s’intéresse aux travaux réalisés en sociologie des organisations, en psychologie sociale et en psychologie. Mais malgré cette représentation maslownienne, qui intègre notamment un besoin d’appartenance à un groupe, le management est paradoxalement calqué sur une logique du « diviser pour mieux régner » : elle s’applique au travers de la hiérarchisation de la valeur des activités humaines (du manuel à l’intellectuel, des sciences dures aux sciences douces), qui entraîne hiérarchisation et mise en compétition des services, et ayant ainsi pour conséquence l’hyperspécialisation des individus « à la tâche » (ce phénomène a vu le jour avec le taylorisme, mais s’accentue avec le management), adaptant l’humain à la technique et non l’inverse : comment peut-on imaginer ainsi réalisable de s’accomplir et se révéler personnellement, si nous ne faisons que répéter toute notre vie la même tâche à laquelle nous nous sommes adaptés ?1. Il serait vain d’insister ici sur les dysfonctionnements et dérèglements organisationnels et cognitifs qu’entraînent capitalisme et management, mais aussi les troubles psychosociaux (comme le burn-out) et l’accentuation des inégalités (emplois plus précaires pour les postes non qualifiés, accentuation de la fracture sociale, etc.).
Malheureusement, cette « quinte gagnant » – idéologie néo-libérale, science économique néo-classique, modèle socio-économique capitaliste, technique d’organisation du travail managériale, progrès technique « déraisonné » –, complètement normal et banal aux yeux de bons nombres d’ingénieurs, perpétuent des conséquences qui sont déjà tragiques.
Tout d’abord, sur le plan social, avec la déstructuration des logiques collectives et solidaires : l’individualisme a trouvé sa place comme « principe fondamental » qui régit les rapports sociaux grâce à la liberté économique qu’offre le néo-libéralisme. Cette liberté nous permet d’exprimer nos pouvoirs créateurs au travers de l’entrepreneuriat et/ou la création de produits et de services dans une vision « déraisonné » du progrès technique – au détriment d’autres formes d’organisation coopératives et associatives, et d’une réflexion critique sur la technique ; et notre pouvoir d’achat grâce à une consommation de produits et services répondant majoritairement à un idéal de « notre propre bonheur » complètement spéculatif. Un individualisme qui exacerbe nos penchants les plus égoïstes, à tel point que nombreux se résignent à penser que
c’est La nature profonde de l’Humain et que l’altruisme n’est qu’un mythe. Il est aussi flagrant de constater que les « médecins » des troubles psychosociaux s’incarnent davantage dans les métiers psychologiques – voire psychologisants –, plus que dans les professions sociologiques : ces derniers remettant en cause un ordre établi, il est difficile pour les donneurs d’ordre de leur faire un accueil empathique, notamment dans les organisations managériales du travail, comme peuvent en témoigner les nombreux cas de burn-out traités dans des cadres psychologiques et non sociologiques, réduisant ainsi le problème organisationnel à la conséquence qu’il a sur l’individu. L’individualisme est le caractère profond de la déstructuration des logiques collectives et solidaires, en cherchant à rendre l’individu roi, plutôt que le peuple souverain.
Quant au deuxième volet de conséquences, celui-ci est d’ordre écologique. On dit que les activités humaines sont sources de modifications environnementales différentes de son évolution naturelle, et ce, depuis la première révolution industrielle : c’est l’ère Anthropocène avec la modification des couches géologiques, le dérèglement climatique, les pollutions des sols, de l’air et des eaux. Rappelons que le postulat premier du libéralisme, c’est le primat de l’activité économique sur toutes les autres : cette aspiration nous dépasse largement aujourd’hui, se développant comme une forme d’entité autonome qui capte toutes les ressources, humaines et naturelles, pour son développement propre ; ressources, qui dans un second postulat, sont considérées comme illimitées par les tenants de cette idéologie. Il est temps de prendre conscience que ce sont les activités économiques qui perturbent l’environnement, et il s’agirait peut-être que l’Activité humaine se donne l’ambition et les moyens de la ralentir.
Et les conséquences pour l’avenir peuvent être nombreuses sur le plan environnemental : accentuation de la désertification, dégel du permafrost, montée des eaux, etc. mais aussi sur le plan politique et social : accentuation des inégalités Nord-Sud, migrations climatiques, intensification des conflits armés pour le contrôle de ressources vitales, etc. Malgré tous les efforts que certains peuvent faire dans l’autre sens, si l’on continue avec ce régime politique, ces conséquences seront inévitables.
Mais alors, s’il s’agit de révolutionner la société, sortir de l’individualisme, avoir des outils de compréhension des contextes plus complexes, partager les moyens de production, redonner le pouvoir aux citoyens-consommateurs-travailleurs de construire par eux-mêmes la société à laquelle ils aspirent, comment pouvons-nous révolutionner l’ingénierie pour qu’elle envisage et construise ces perspectives ? Je vous invite à suivre la suite de ce premier article en octobre prochain…
Arnaud DE MARIA
π’K’n’JAH (47e promotion)


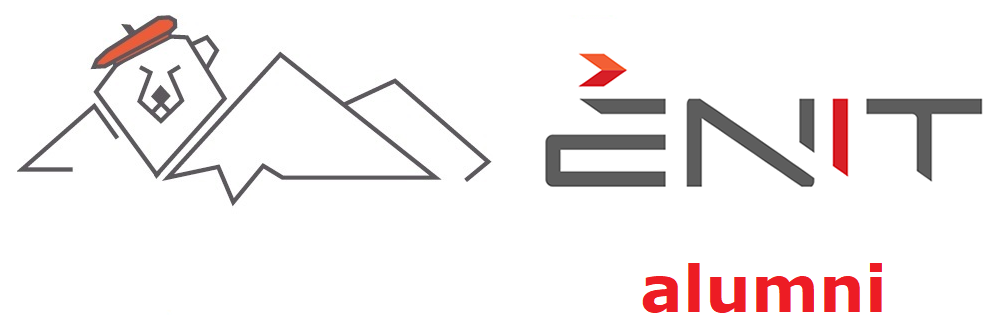


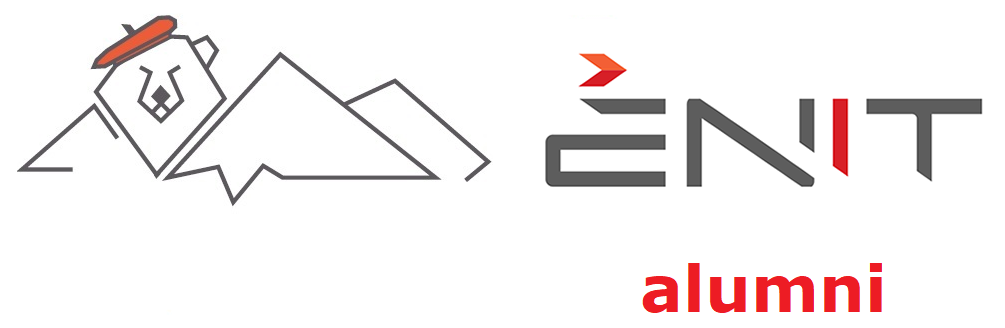

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.